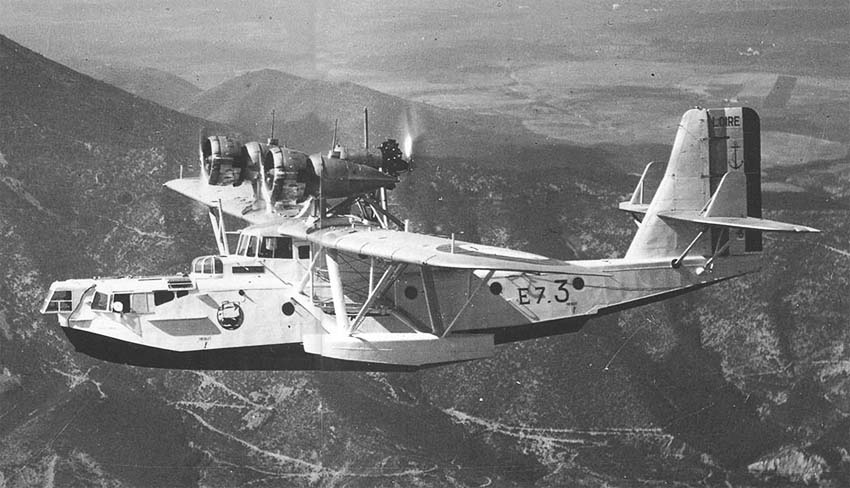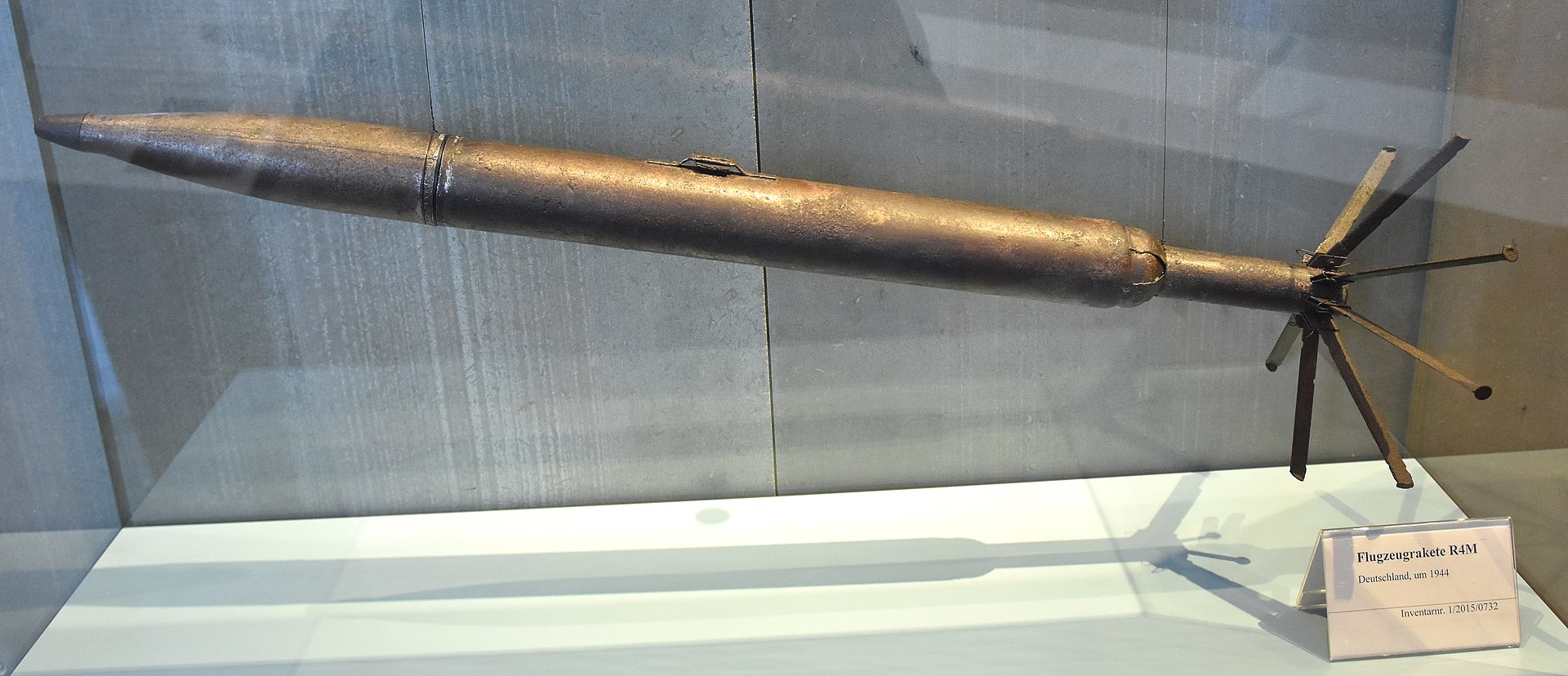{Sources principales : En., De., Es., Fr., Ru., Wikipedia ; W. Green et al., The complete Book of Fighters }
En 1934, le service d'aviation de l'Armée Impériale Japonaise émit un programme pour obtenir un chasseur plus rapide que le biplan Kawasaki Ki-10 qui était en service depuis la fin de 1935 (sachant que son 1er vol datait de Mars de la même année !).
 |
| Kawasaki Ki-10 : Un biplan très propre |
Ce biplan, assez rapide (400 km/h), avait battu le monoplan Nakajima Ki-11, plus rapide (420 km/h) mais significativement moins manœuvrant (?).
{En passant, je ne vois aucune ressemblance entre le Boeing P 26 à l'aérodynamisme très, très archaïque et le Nakajima Ki-11, considérablement plus évolué.}
Trois monoplans prototypes de trois constructeurs différents furent produits.
Kawasaki proposait son Ki-28 animé par un moteur V 12 à refroidissement par liquide.
Ce chasseur était le plus rapide des trois grâce à un maître-couple réduit et à une aérodynamique plus fine (sauf son radiateur).
Sa vitesse était de 485 km/h à une altitude de 3 500 m.
Il montait à 5 000 m en 5' 10".
Malheureusement, le rayon de ses virages était trop élevé.
Mitsubishi sortait un dérivé de son chasseur embarqué A5M, le Ki-33.
Cet avion était issu de la dé-navalisation du chasseur embarqué A5M.
En vitesse, il "gagnait" juste 4 km/h sur le Nakajima (la marge d'erreur instrumentale).
Très curieusement pour un avion issu d'un chasseur embarqué, sa maniabilité était insuffisante et, surtout, il perdait 1 700 m de plafond, ce qui était stratégiquement ennuyeux sachant que les bombardiers G3M devaient bombarder des navires de ligne depuis 8 000 m.
Nakajima, enfin, proposait son Ki-27, non seulement évolution du Ki-11 refusé par l'Armée Impériale, mais aussi du Ki-12 (conçu autour d'un moteur Hispano 12 X avec le soutien de 2 ingénieurs de Dewoitine qui avaient démontré l'intérêt des structures monocoques).
Le Nakajima Ki-27 était donc de structure monocoque intégralement métallique.
Long de 7.53 m, il avait une masse à vide de 1 110 kg.
Cette masse passait à 1 547 kg au décollage - en mission d'interception - puis à 1 790 kg au maximum (avec 4 bombes de 25 kg).
(Mon choix de la valeur de la masse normale au décollage du Wikipedia en Espagnol traduit le fait que les Japonais ayant pris très rapidement les Philippines, le Ki-27 y fut très utilisé, donc bien connu, et l'on y parle couramment l'Espagnol depuis Magellan).
L'envergure de 11.31 m permettait une surface alaire de 18.56 m².
En conséquence, la charge alaire - en mission d'interception - ne dépassait pas 83.4 kg/m².
Le Ki 27 atteignait les 470 km/h et montait à 5 000 m en 5' 22" (à comparer avec les 6' 03" du Fiat G 50).
La perte de performances par rapport au Ki 28 était quasi insignifiante, mais le Ki-27 tournait un 360° en à peine plus de 8".
Son plafond varie suivant les sources de 12 250 m (!) à 10 200 m.
Ainsi, il gagna le concours et entra en service en fin 1937.
| Nakajima Ki-27 - (Naté) |
Le Ki-27 fut alors couramment appelé Nate pour rappeler qu'il était le produit des industries métallurgiques Nakajima (Nakajima Tekkosho).
Il fut employé directement en Chine dès 1937 contre les avions de Tchang Kaï Tcheck comme vous pourrez le voir sur la vidéo donnée en lien.
On y voit un pilote Japonais très habile attaquant un chasseur biplan Curtiss Hawk III Chinois (vitesse maximale de 410 km/h).
L'avion donna tout de suite satisfaction jusqu'aux incidents de Khalkhin Gol (11 Mai --> 16 Septembre 1939), contre la Russie soviétique.
Alors que les pilotes Japonais avaient rencontré uniquement des pilotes chinois (ou assimilés) dont l'entraînement était moins intense que le leur et dont les avions étaient plus anciens que les leurs
Désormais, ils devaient faire face à des avions modernes pilotés par des pilotes bien entrainés.
Pire encore, ces hommes étaient plus de 200 et disposaient, d'au moins autant d'avions.
 |
| Polikarpov I-15 - le capot moteur est juste un médiocre anneau Townend. |
L'armée soviétique, commandé par le général Blücher, d'abord malmenée, fut ensuite dirigée par Gueorgui Joukov, un homme qui, lui, savait mener une guerre moderne.
Il renforça sans cesse son armée après y avoir organisé une logistique efficace et une sérieuse défensive.
 |
| I 153 capturé par les Finlandais apparemment pendant la Guerre d'Hiver (il est peint en blanc) - Le capot moteur est à la fois plus aérodynamique et plus adapté aux froids hivernaux Russes que celui du I 15. Le train est éclipsable (à la manivelle). |
Cela concernait aussi les modèles d'avions, en particulier sur le plan de la chasse où les anciens chasseurs biplans Polikarpov I-15 (365 km/h) laissaient la place à des Polikarpov I-153 (443 km/h à 4 600 m).
Les Polikarpov I-16 vinrent ensuite
Eux avaient des sièges blindés et un moteur plus puissant qui assurait une vitesse plus grande, en particulier les I 16 type 24, capables de voler à 525 km/h à 4 600 m d'altitude.
Ces chasseurs là résistaient aux mitrailleuses Japonaises de 7.7 mm (V0 : 820 m/s).
Par contre, les divers alourdissements entraînèrent un allongement du temps de virage sur 360° : 18 secondes au lieu de 15, mais le Bf 109 Emile prenait, lui, 25" pour effectuer la même manœuvre, ce qui devenait dangereux pour lui en combat
 |
| Polikarpov I-16 - Les échappements propulsifs paraissent faiblement orientés vers l'arrière, mais il est probable qu'il s'agissait d'un compromis entre la propulsion et le risque d'incendie. |
La confrontation URSS - Japon en Mandchourie sur le plan aéronautique, allait reposer sur 550 avions soviétiques et moins de 300 avions Japonais, dont environ 200 Nate.
 |
| Une partie d'une escadrille de Nate à Khalkhin Gol - l'hélice est bipale à pas variable. On peut dire que, ici, la protection et le camouflage des chasseurs sont minimaux. |
D'après ce site, les essais soviétiques d'un Ki-27 montrèrent que le chasseur Japonais surclassait ses adversaires du moment. Je recopie :
"Au cours des essais en Russie d’un Ki-27 capturé, l’avion s’est révélé supérieur à l’I-152 (I-15bis), I-153 et même le I-16 en combat aérien, ainsi qu’au décollage plus rapide et une vitesse d’atterrissage inférieure, nécessitant des pistes d’atterrissage plus courtes que l’I-16 (qui nécessitait 270 mètres pour s'arrêter et 380 mètres pour décoller)".
Cependant, les chasseurs soviétiques bénéficiaient de l'avantage du nombre, qui restera toujours un facteur essentiel dans n'importe quelle guerre (Théorie de Lanchester).
L'armée du Kwantung bénéficiait d'une énorme liberté d'action et ses chefs misaient avant tout sur l'entrainement remarquable de leur Infanterie.
Ils étaient peu conscients :
- de l'importance du renseignement aérien,
- du rôle de l'artillerie lourde (qu'ils ne protégèrent jamais sérieusement) et
- du rôle des chars, qui, par ailleurs, chez eux, étaient de qualité médiocre.
Un certain temps après, en 1941, notre armistice du 25 Juin 1940, les Ki-27 allèrent se confronter à la poignée de Morane 406 toujours présents en Indochine Française.
Les Nate ne firent qu'une bouchée des Morane (2 avions abattus et le 3ème très endommagé (CJ Ehrengardt & CF Shores, L'aviation de Vichy au combat, tome I, p. 95)..
Le soi-disant meilleur chasseur du monde était irrémédiablement défavorisé par rapport à ces très légers chasseurs Nippons.
Sa masse était exagérée parce qu'il avait une structure antédiluvienne (assemblage de tubes et toiles choisi pour réparer facilement avec des bouts de ficelles).
Par rapport au Ki-27, il tournait un 360° bien plus difficilement (18" au lieu de 8"), il montait très lentement (10' au lieu de 5' 22" pour 5 000 m, 18' pour 7 000 m).
Ainsi, le Japon s'assura, à nos dépens, de l'alliance du Siam (Thaïlande).
Mais aussi, et surtout, ils allaient bénéficier de nos bases aériennes pour attaquer les Indes Néerlandaises (devenue l'Indonésie).
Ce sera de ces bases qu'ils partirent le 10 Décembre 1941 pour détruire la force Z Britannique.
On cite aussi, par curiosité, un P 38 Lightning descendu par un Nate et un P 51 endommagé par un (ou des) Nate Thaïlandais !
Mon idée farfelue
La France avait de plutôt bonnes relations avec le Japon avant 1940.
Je suis donc étonné que nous n'ayons pas essayé de vendre le moteur Gnome et Rhône 14 Mars aux constructeurs Japonais.
Certes ce moteur pesait 400 kg (soit 50 kg de plus que le moteur employé par le Nate), mais il avait une surface frontale qui représentait 55% de celle du fuselage du Ki-27.
Il aurait donc pu gagner en vitesse sans perdre beaucoup de maniabilité.
Conclusion
Les plus de 3 380 chasseurs Nate ki-27 assurèrent la maîtrise du ciel de l'Armée Impériale Japonaise pendant 4 années sans faiblir.
La défaite de 1939, en Mongolie, n'était en rien la leur, mais bien celle de l'Armée du Kwantung, particulièrement mal commandée (manque absolu de professionnalisme, par manque de travail des "chefs").
La mauvaise réputation faite à cet avion a été créée par ceux qui avaient inventé des avions lourds que cet objet sautillant ridiculisait (P 40, P 38, Hurricane).
En grande partie, cela montre que les services de renseignement Japonais ont été peu performants.
Cette réputation actuelle a été amplifié par l'immobilisme technique des services de l'Armée Japonaise, incapables d'armer ces avions avec des 12.7 mm, comme ils furent tout aussi incapables de tester à temps le moteur Mitsubishi Kinseï sur le Zéro (puis sur le Reppu) !
En 1937, tourner un 360° en 8" était un sacré atout, surtout si les adversaires ne volaient pas 100 km/h de plus que lui !
Pour Mr le ministre de l'air Pierre Cot, le Morane 406 était très maniable.
Or, il tournait un 360° en 18" (Détroyat) : Sa maniabilité était donc moyenne, juste meilleure que celle du Bf 109 Emile (25").
Si ce Morane avait réellement disposé d'une vitesse de 490 km/h, il s'en serait sorti.
Avec 450 km/h, il ne pouvait même pas survivre à un Nate armé juste de deux 7.7 mm.
Les Nate, eux, bien que très fragiles, ont combattu jusqu'en 1945 (même sous nos couleurs, en Indochine), mais à ce moment-là, ils étaient complètement rincés !
Ils donnèrent naissance à un avion nettement meilleur, le Nakajima Ki-43 Hayabusa mais le commandement n'ayant pas changé, la défaite était prévisible.
La défaite Japonaise à Khalkhin Gol a scellé aussi la défaite du IIIème Reich dès l'automne 1940, parce que le Japon a été dissuadé d'attaque sérieusement l'URSS.